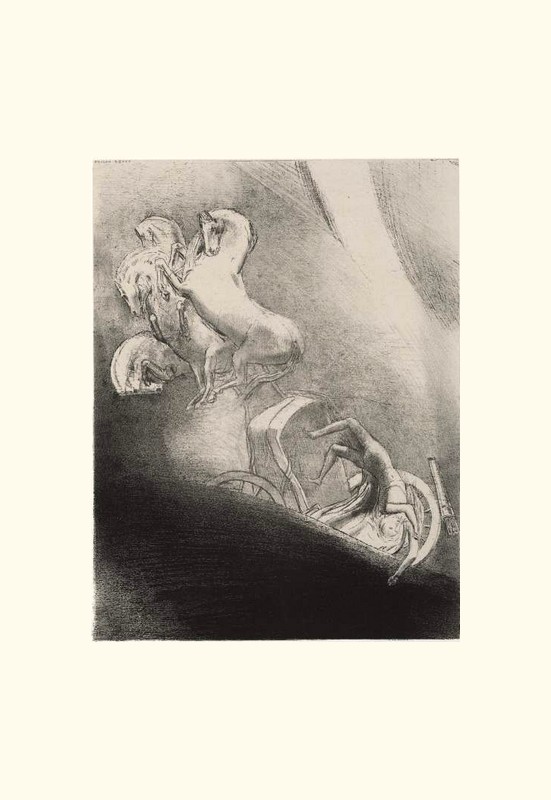Lettres de Arthur Rimbaud (9)
Marseille, 15 juillet 1891
Ma chère Isabelle,
Je reçois ta lettre du 13, et trouve occasion d'y répondre de suite. Je vais voir quelles démarches je puis faire avec cette note de l'intendance et le certificat de l'hôpital. Certes, il me plairait d'avoir cette question réglée ; mais, hélas ! je ne trouve pas moyen de le faire, moi qui suis à peine capable de mettre mon soulier à mon unique jambe. Enfin, je me débrouillerai comme je pourrai. Au moins, avec ces deux documents, je ne risque plus d'aller en prison : car l'administration militaire est capable d'emprisonner un estropié, ne fût-ce que dans un hôpital. Quant à la déclaration de rentrée en France, à qui et où la faire ? Il n'y a personne autour de moi pour me renseigner ; et le jour est loin où je pourrai aller dans des bureaux, avec mes jambes de bois, pour m'informer.
Je passe la nuit et le jour à réfléchir à des moyens de circulation : c'est un vrai supplice. Je voudrais faire ceci et cela, aller ici et là, voir, vivre, partir : impossible, impossible au moins pour longtemps, sinon pour toujours ! Je ne vois à côté de moi que ces maudites béquilles : sans ces bâtons je ne puis faire un pas, je ne puis exister. Sans la plus atroce gymnastique, je ne puis même m'habiller. Je suis arrivé presque à courir, il est vrai, avec mes béquilles ; mais je ne puis monter ou descendre des escaliers, et, si le terrain est accidenté, le ressaut d'une épaule à l'autre me fatigue beaucoup. J'ai une douleur névralgique très forte dans le bras et l'épaule droite, et, avec cela, la béquille qui scie l'aisselle ! J'ai une névralgie encore dans la jambe gauche, et, avec tout cela, dire qu'il faut faire l'acrobate tout le jour pour avoir l'air d'exister !
Voici , ma chère sœur, ce que j'ai considéré en dernier lieu comme cause de ma maladie. Le climat du Harar est froid de novembre à mars. Moi, par habitude, je ne me vêtais presque pas : un simple pantalon de toile et une chemise de coton. Avec cela des courses à pied de 15 à 4o kilomètres par jour, des cavalcades insensées à travers les abruptes montagnes du pays. Je crois qu'il a dû se développer dans le genou une douleur arthritique causée par la fatigue, et le chaud et le froid. En effet, cela a débuté par un coup de marteau (pour ainsi dire) sous la rotule, léger coup qui me frappait à chaque minute ; grande sécheresse de l'articulation et rétraction du nerf de la cuisse. Vint ensuite le gonflement des veines tout autour du genou, gonflement qui faisait croire à des varices. Je marchais et travaillais toujours beaucoup, plus que jamais croyant à un simple coup d'air. Puis la douleur dans l'intérieur du genou a augmenté. C'était, à chaque pas, comme un clou enfoncé de côté. Je marchais toujours, quoique avec plus de peine ; je montais surtout à cheval dont, chaque fois, je descendais presque estropié. Puis le dessus du genou a gonflé, la rotule s'est empâtée, le jarret aussi s'est trouvé pris. La circulation devenait pénible et la douleur secouait les nerfs, jusqu'à la cheville et jusqu'aux reins. Je ne marchais plus qu'en boitant fortement et me trouvais toujours plus mai. Mais j'avais toujours beaucoup à travailler, forcément. J'ai commencé alors à tenir ma jambe bandée du haut en bas, à frictionner, baigner, etc., sans résultat. Cependant, l'appétit se perdait. Une in- somnie opiniâtre commençait. Je faiblissais et maigrissais beaucoup. Vers le 15 mars, je me décidai à me coucher, au moins à garder la position horizontale. Je disposai un lit entre ma caisse, mes écritures et une fenêtre d'où je pouvais surveiller mes balances au fond de la cour, et je payai du monde de plus pour faire marcher le travail, restant moi-même étendu, au moins de la jambe malade. Mais, jour par jour, le gonflement du genou le faisait ressembler à une boule. J'observai que la face interne de la tête du tibia était beaucoup plus grosse qu'à l'autre jambe. La rotule devenait immobile, noyée dans l'excrétion qui produisait le gonflement du genou et que je vis avec terreur devenir en quelques jours dure comme de l'os. A ce moment, toute la jambe devint raide, complètement raide, en huit jours ; je ne pouvais aller aux lieux qu'en me traînant. Cependant, la jambe et le haut de la cuisse maigrissaient, maigrissaient, le genou et le jarret toujours gonflant, se pétrifiant ou plutôt s'ossifiant ; et l'affaiblissement physique et moral empirait. Fin mars, je résolus de partir. En quelques jours, je liquidai tout à perte ; et, comme la raideur et la douleur m'interdisaient l'usage du mulet ou même du chameau, je me fis faire une civière couverte d'un rideau, que 16 hommes transportèrent à Zeilah en une quinzaine de jours. Le second jour du voyage, m'étant avancé loin de la caravane, je fus surpris dans un endroit désert par une pluie sous laquelle je restai étendu 16 heures sous l'eau, sans abri et sans possibilité de me mouvoir : cela me fit beaucoup de mal. En route, je ne pus jamais me lever de ma civière. On étendait la tente au-dessus de moi à l'endroit même où l'on me déposait ; et, creusant un trou de mes mains près du bord de la civière, j'arrivais difficilement à me mettre de côté pour aller à la selle sur ce trou qu'ensuite je comblais de terre. Le matin, on enlevait la tente au-dessus de moi ; puis on m'enlevait. J'arrivai à Zeilah, éreinté, paralysé. Je ne m'y reposai que quatre heures : un vapeur partait pour Aden. Jeté sur le pont sur mon matelas (il a fallu me hisser à bord dans ma civière !) je dus souffrir trois jours de mer sans manger. À Aden, nouvelle descente en civière. Je passai ensuite quelques jours chez M. Tian pour régler nos affaires et partis à l'hôpital où le médecin anglais, après quinze jours, me conseilla de filer en Europe.
Ma conviction est que cette douleur de l'articulation, si elle avait été soignée dès les premiers jours, se serait calmée facilement et n'aurait pas eu de suites. Mais j'étais dans l'ignorance de cela. C'est moi qui ai tout gâté par mon entêtement à marcher et à travailler excessivement.
Pourquoi, au collège, n'apprend-on pas de la médecine, au moins le peu qu'il faudrait à chacun pour ne pas faire de pareilles bêtises ?
Si quelqu'un, dans le cas où je me trouvai ensuite, me consultait, je lui dirais : Vous en êtes arrivé à ce point ? Ne vous laissez jamais amputer. Faites- vous charcuter, déchirer, mettre en pièces ; mais ne souffrez pas qu'on vous ampute. Si la mort vient, ce sera toujours mieux que la vie avec des membres de moins. Et cela, beaucoup l'ont fait ; et, si c'était à recommencer, je le ferais. Plutôt souffrir un an comme un damné que d'être amputé !
Voici le beau résultat : je suis assis et, de temps en temps, je me lève et sautille une centaine de pas sur mes béquilles, puis je me rasseois. Mes mains ne peuvent rien tenir. Je ne puis, en marchant, détourner la tête de mon seul pied et du bout des béquilles. La tête et les épaules s'inclinent en avant, et vous bombez comme un bossu. Vous tremblez à voir les gens et les objets se mouvoir autour de vous, crainte qu'ils ne vous renversent pour vous casser la seconde patte. On ricane à vous voir sautiller. Rassis, vous avez les mains énervées, l'aisselle sciée et la figure d'un idiot. Le désespoir vous reprend ; et vous demeurez assis comme un impotent complet, pleurnichant et attendant la nuit, qui rapportera l'insomnie perpétuelle et la matinée encore plus triste que la veille, etc., etc. La suite au prochain numéro.
Avec tous mes souhaits,
RIMBAUD

Marseille, le 20 juillet 1891
Ma chère soeur,
Je vous écris ceci sous l'influence d'une violente douleur dans l'épaule droite ; cela m'empêche presque d'écrire, comme vous voyez.
Tout cela provient d'une constitution devenue arthritique par suite de mauvais soins. Mais j'en ai assez de l'hôpital, où je suis exposé aussi à attraper tous les jours la variole, le typhus, et autres pestes qui y habitent. Je pars, le médecin m'ayant dit que je puis partir et qu'il est préférable que je ne reste point à l'hôpital.
Dans deux ou trois jours je sortirai donc et verrai à me traîner jusque chez vous comme je pourrai ; car, dans ma jambe de bois, je ne puis marcher et même avec les béquilles je ne puis pour le moment faire que quelques pas, pour ne point faire empirer l'état de mon épaule. Comme vous l'avez dit, je descendrai à la gare de Voncq. Pour l'habitation je préférerais habiter en haut ; donc inutile de m'écrire ici, je serai très prochainement en route.
Au revoir.
RIMBAUD

Ainsi finit la correspondance d'Arthur Rimbaud. Il rentre donc dans sa famille à Roche, où, il y restera un mois ; puis, il retournera à l'hôpital de Marseille accompagné par sa sœur, et il y mourra le 10 novembre 1891. Et comme dit en introduction, la veille de sa mort le 9 novembre 1891, il dictera, pour le directeur des Messageries maritimes, une lettre dans laquelle il demande à être transporté à bord d'un vapeur en partance pour l'Orient.
Pages : I II III IV V VI VII VIII IX
Dernières lettres d'Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854 à Charleville, et mort le 10 novembre 1891 à Marseille.